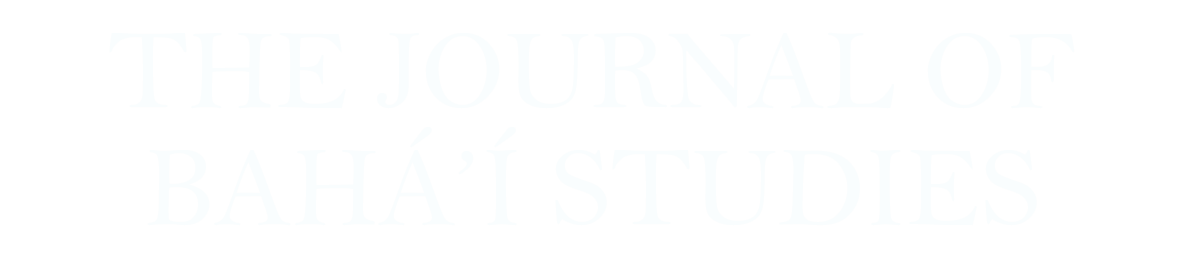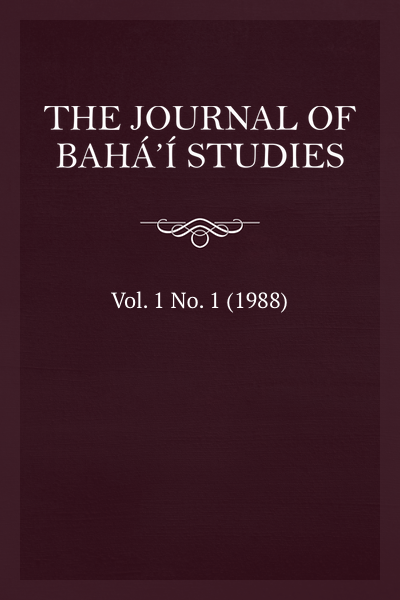Résumé
Selon l’auteur, en raison, du moins partiellement, de la controverse qui a dominé la question de l’instruction religieuse, les écoles se sont abstenues d’enseigner aux enfants des principes de comportement fondés sur la morale et la déontologie. Au lieu de cela, on a enseigné aux enfants que la morale est relative et qu’elle est déterminée par l’appartenance culturelle, raciale ou ethnique. En d’autres termes, nous enseignons une sorte de “pluralisme moral” qui suppose que des codes moraux contradictoires peuvent coexister. Nous vivons toutefois dans un monde dominé par une interdépendance grandissante, un monde au sein duquel un code moral universel apte à gérer nos rapports est devenu indispensable. Nous sommes pris entre la nécessité d’opérer en tant que culture de dimension mondiale et la conviction que nous devons à tout prix préserver des identités raciales, culturelles et ethniques distinctes. L’auteur invite à la création d’un enseignement qui viserait à mettre l’enfant en contact avec son identité spirituelle, elle-même fondée sur des qualités et des talents d’origine divine, plutôt qu’avec une identité fondée sur des caractéristiques de race, de classe sociale, d’appartenance religieuse ou ethnique. Les stratégies proposées par l’auteur peuvent être mises en pratique aussi bien par les parents que par les éducateurs pour amener l’enfant à développer une identité avec l’humanité entière, ainsi qu’un code moral commun pouvant s’appliquer à toute conduite.

Cette œuvre est sous licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International.